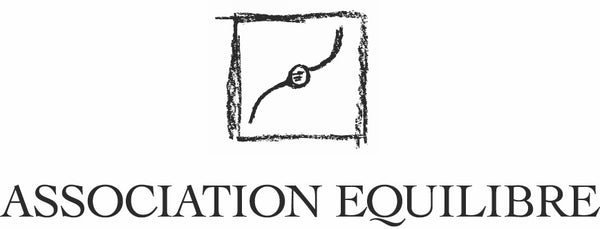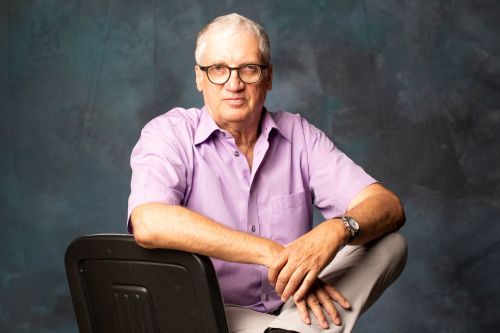
Une interview passionnante avec le Président
Partager
Franz Huber, entrepreneur uranais et fondateur de KoKoTé, partage ses réflexions sur ce qui compte pour lui en tant qu'entrepreneur et comment il en est venu à créer un projet d'éducation et d'intégration pour les réfugiés. Il définit également sa conception de l'entrepreneuriat responsable, dont le projet d'intégration et la marque de sacs KoKoTé sont un exemple de réussite.
Vous avez déjà dirigé plusieurs entreprises, dont l'entreprise familiale Hubrol AG, fournisseur de fioul de Suisse centrale, que vous avez transformée en une entreprise plus respectueuse de l'environnement. Cependant, vous avez également dû accepter des échecs avec d'autres idées et entreprises. Qu'est-ce qui vous motive à toujours innover ?
Un entrepreneur agit, tout simplement (sourires). Parfois ça marche, parfois non. Avec KoKoTé, j'ai simplement démarré sans idée concrète. Je rédige des business plans, mais ils deviennent obsolètes environ tous les trois mois (rires). Au départ, tout a commencé par des transformations immobilières. Je m'intéresse à la manière dont on peut développer quelque chose. Il y a 30 ans, j'ai décidé que chauffer au fioul n'était pas très intelligent. Depuis, j'étudie comment cela pourrait évoluer. C'est ce qui m'a motivé. Plus jeune, j'étais surtout attiré par des idées qui semblaient impossibles. Ma motivation était maximale quand on me disait : « C'est impossible ». C'est pour ça que j'ai connu quelques échecs. On peut parfois rattraper un peu la sagesse de l'âge, mais jamais complètement (rires).
Selon vous, quelles sont les caractéristiques les plus importantes d’un entrepreneur ?
Il ne s'agit pas avant tout de maximiser l'argent, mais de réaliser quelque chose de significatif. Si une idée est mûrement réfléchie et convaincante, elle fonctionne généralement. Dans le monde des affaires, nombreux sont ceux qui ont des idées mais pas d'argent, et d'autres qui ont de l'argent mais pas d'idées. Il faut trouver un juste milieu. L'argent n'est pas le seul objectif, mais il joue toujours un rôle. Chez KoKoTé aussi, notre objectif est de gagner nous-mêmes l'argent dont nous avons besoin en trois ou quatre ans afin d'amortir nos machines, d'être à la pointe et de pouvoir réagir aux nouvelles évolutions. Je pense aussi qu'il est important que les entrepreneurs ne se contentent pas de dire que leurs employés sont leur priorité, mais qu'ils vivent en accord avec cette priorité. Pour éviter toute contradiction entre théorie et pratique. Si l'on garde ces deux ou trois maximes à l'esprit, on a déjà accompli beaucoup de choses.
Vous êtes pleinement engagé dans l'entrepreneuriat responsable. Qu'entendez-vous exactement par ce terme ?
Gagner de l'argent ne me tente pas. Le sens est très important pour moi, tout comme la vision d'ensemble. Aucun étranger ne devrait payer le prix du succès. Que ce soit la nature, l'exploitation d'un employé ou d'un fournisseur, ou l'escroquerie de clients. Tout le monde doit y gagner. Chez Hubrol AG, nous avons mis en place des systèmes de participation des employés à tous les niveaux il y a 30 ans. Si l'entreprise prospère et que seul le propriétaire en tire profit, je ne pense pas que ce soit responsable ni honnête. Qu'il s'agisse d'une petite entreprise, de Microsoft ou d'Amazon, ce n'est pas un génie qui a mené ces entreprises aussi loin. C'est un système global qui ne fonctionne que si les gens travaillent bien ensemble. Si une seule personne est le patron, c'est plus une coïncidence qu'une intention. Si l'on suppose qu'un artisan est soit un bon artisan, soit un bon vendeur, rarement les deux. Si le vendeur arnaque ensuite l'artisan, alors ce n'est pas éthique à mon avis.
Les inégalités ont été exacerbées par la pandémie, qui a également révélé les faiblesses du système économique actuel. Selon vous, devrions-nous emprunter cette voie plus responsable ?
Absolument. Il s'agit de garantir la visibilité de tous les participants et que personne ne paie un prix caché ni ne subisse de préjudice pour réussir. Et cela vaut non seulement pour moi en Suisse, mais aussi pour le monde entier. Si je travaille proprement en Suisse, mais que je peux réaliser des bénéfices parce que je produis dans un pays à bas salaires où aucune mesure de sécurité au travail n'est respectée, alors ce n'est pas éthique pour moi. Cela vaut également pour nous chez KoKoTé. Chez KoKoTé, nous utilisons exclusivement des produits recyclés. Pour nous, le choix réfléchi des matériaux n'est pas un argument marketing, mais une question de conviction.
Comment en êtes-vous venu à mettre en place un projet d’éducation et d’intégration pour les réfugiés ?
Revenons un peu en arrière. À 19 ans, je voulais étudier la psychologie. Mais mon père voulait que j'intègre l'entreprise et que je suive la formation commerciale, et c'est ce que j'ai fait. Trente ans plus tard, j'ai suivi une formation de consultante et coach systémique. Chaque formation a un impact. J'ai réalisé que vivre en Suisse n'est pas un mérite, mais une question de chance. Et que j'ai eu beaucoup de chance, à bien des égards. Je voulais créer quelque chose pour ceux qui n'avaient pas ma chance. C'est donc tout naturellement qu'en 2015, j'ai choisi de travailler pour les réfugiés.
Comment vous est venue l’idée de développer des produits dans le secteur des sacs/accessoires, un marché très concurrentiel ?
Ma première pensée n'a pas été : comment gagner de l'argent ? Je voulais combiner travail et études, et pour bien coudre, il n'est pas nécessaire de parler couramment l'allemand. Les réfugiés en Suisse ont souvent de très bonnes compétences artisanales. Certains savent coudre, et c'est déjà le cas dans leur pays d'origine, en Afghanistan, en Somalie et en Syrie. C'est un savoir-faire qui a presque disparu ici. Nous voulions exploiter cette ressource, et c'est ainsi que nous avons commencé. Combiner cela avec un domaine où l'on est bon facilite l'apprentissage d'une langue difficile, à savoir l'allemand et l'orientation. Petit à petit, un système de travail et de formation s'est développé au sein de l'entreprise, alliant travaux pratiques et possibilités d'apprentissage plus ou moins intenses.
KoKoTé a parcouru un long chemin en si peu de temps. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans l'histoire du projet jusqu'à présent ?
Tout m'a surpris. Je suis impressionné par le nombre d'entrepreneurs sociaux qui commandent des sacs d'entreprise chez nous. Ils pourraient les commander bien moins cher en Chine. De nombreuses PME, en particulier, ont des dirigeants dont l'économie sociale de marché est non seulement inscrite dans leur mission, mais qu'ils mettent également en œuvre.
Le projet existe depuis 2015. Nous avons lancé l'entreprise sous la marque KoKoTé fin 2019 et avons atteint nos objectifs budgétaires en 2020, malgré l'impact considérable du confinement. J'en ai été très surpris. Et ce chiffre était réparti équitablement entre les activités B2C et B2B. Depuis le début de la pandémie, on parle beaucoup d'intérêt personnel et d'égoïsme, mais lorsque je suis en déplacement, que ce soit avec des clients professionnels ou des particuliers, je suis toujours étonné de voir combien de personnes engagées socialement apprécient la qualité, et la valorisent.
Ce qui m'étonne toujours, c'est que nous ne vendons pas les produits que je préfère, mais que les clients préfèrent généralement d'autres produits. Apparemment, je n'ai pas le flair pour ça (rires), et nous développons nos produits en équipe avec Carsten Joergensen.
Quelle est votre vision actuelle de KoKoTé ? Où voyez-vous la marque dans deux ou trois ans ?
J'ai plusieurs visions. Je veux que la marque KoKoTé devienne le symbole extérieur d'une attitude intérieure. Et que l'idée soit copiée et diffusée. J'ai 68 ans aujourd'hui et, dans les prochaines années, je souhaite que l'entreprise devienne financièrement indépendante. Beaucoup des personnes dévouées de KoKoTé travaillent bénévolement ; ma femme Yvonne Herzog et moi les rémunérons même (rires). Pour moi, la réussite économique est essentielle. Je ne veux pas maintenir artificiellement une idée en vie ; elle doit faire ses preuves financièrement.
Vous avez fondé la société JLT et KoKoTé avec votre épouse, Yvonne Herzog. Comment fonctionne votre collaboration et comment conciliez-vous vie privée et vie professionnelle ?
Nous ne séparons pas vie privée et vie professionnelle. À 50 ans, nous avons décidé ensemble de ne faire que ce qui nous plaisait. Ce n'est pas si simple. Je m'enthousiasme très vite pour une idée. L'inconvénient, c'est que je me retrouve parfois impliqué dans des projets où je me dis soudain : « Oh, je ne voulais pas ça du tout ! » Aujourd'hui, nous avons tous les deux plus de 60 ans et sommes plus déterminés ; ça fonctionne bien. Nous nous complétons. J'ai beaucoup appris de ma femme, et peut-être qu'elle aussi a beaucoup appris de moi. Notre collaboration nous a permis de progresser continuellement.
En plus de votre activité d'entrepreneur, vous êtes également coach. Qui vient vous consulter ?
En tant que consultante, je suis de moins en moins active. J'applique mes connaissances systémiques à mon travail auprès des réfugiés, de mes clients et de mes partenaires. Je trouve cela toujours aussi stimulant.
Avec le recul, votre formation de consultant systémique a-t-elle été un tournant pour vous ? Et a-t-elle contribué de manière significative au succès de KoKoTé ?
Absolument, j'ai beaucoup changé grâce à cette formation. L'un de ses aspects les plus importants est l'approche centrée sur la solution. Elle part du principe qu'il n'y a pas de problèmes, que seules les situations perçues comme problématiques existent et que la solution fait partie du problème. C'est une idée importante qui m'a le plus aidé. Elle est applicable partout. C'est particulièrement difficile lorsqu'il s'agit de diriger des personnes. Si quelqu'un dit une bêtise, on garde en soi de vieux schémas et on s'arrache les cheveux.
Je veux encourager l'employé à trouver lui-même une solution. C'est alors durable. D'abord, il ne posera pas la même question chaque semaine, mais progressera et, au final, tout le monde en bénéficiera. Je trouve cela très stimulant, mais aussi extrêmement stimulant.
Selon vous, que faudrait-il pour qu’une transformation plus fondamentale se produise dans le système économique actuel et pour que les valeurs sociales redeviennent plus importantes ?
Pour faire simple : j’appelle cela une démocratisation de l’économie. Lisa Herzog, économiste et philosophe allemande, auteure d’ouvrages sur le sujet, décrit comment, au Moyen Âge, les rois, les princes et l’Église étaient intouchables. Aujourd’hui, ce sont les grandes entreprises, les soi-disant grands dirigeants, qui ne se comportent ni de manière démocratique, ni transparente, ni respectueuse. Je reconnais qu’on ne peut pas toujours voter démocratiquement sur tout. Mais il faut développer un système où chacun participe au processus décisionnel, autant que possible. Un exemple simple : il ne me viendrait jamais à l’idée d’embaucher un employé sans consulter ses futurs collaborateurs. Si l’équipe ne s’intègre pas, cela ne fonctionnera pas. Si les entreprises sont dirigées par la pression d’en haut, il ne faut pas s’attendre à ce que les informations importantes remontent de la base. Elles n’entendent que ce que les employés souhaitent entendre. De cette façon, ils ne reçoivent pas l’information pertinente. Tôt ou tard, cela aura des conséquences fatales. En biologie, on définit cela ainsi : les systèmes fermés meurent. Cela s'applique également à nous. Cela s'applique également à la question climatique. Nous faisons partie de la nature et vivons avec de nombreux autres êtres vivants. Nous faisons partie d'un tout, et si nous ne nous ouvrons pas, ne réfléchissons pas attentivement à nos interconnexions et ne faisons pas preuve de considération les uns envers les autres, nous mourrons.
Nous traversons une période très particulière et difficile. Quels sont vos vœux personnels pour 2021 ?
J'ai décidé d'y aller un peu plus lentement. J'ai tendance à faire les choses rapidement, ce qui présente de nombreux avantages, mais il n'y a pas d'avantages sans inconvénients. Il y a plus de 25 ans, j'ai essayé de sauver l'usine de chaussures Tessag, mais j'ai échoué. Ce fut très douloureux pour moi. Et j'ai aussi beaucoup appris au cours de ce processus.
Mon intention et mon désir sont de ralentir, car souvent, plus lentement, c'est plus rapide. Ralentir est difficile pour moi ; je suis souvent encore très impatient. Et en ralentissant, je veux prendre soin de ma santé, faire des promenades et faire beaucoup d'exercice en pleine nature.
Merci, Franz, pour cette conversation fascinante !